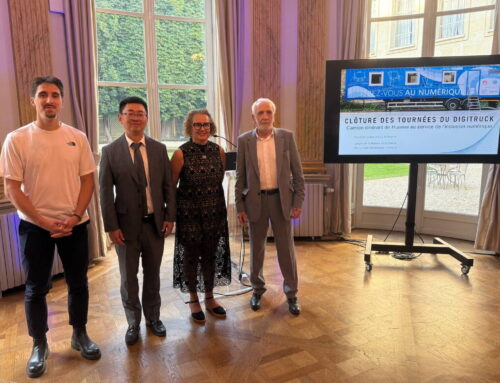Le nucléaire, une énergie verte aux vertus sociales et territoriales
Deux ans après la crise préfiguratrice des gilets jaunes, le pouvoir d’achat s’impose à nouveau dans le débat public. Les prix grimpent : gaz, pétrole, électricité, aliments de première nécessité, sans que les salaires ne suivent la courbe de l’inflation.
Cette montée des prix s’explique en partie à cause de la faible disponibilité de la part nucléaire d’EDF. Au final, pour éviter qu’elle ne pèse trop lourdement sur les ménages français, le groupe public a été contraint de prendre à sa charge la hausse de l’électricité et devra investir massivement dans le nucléaire ; ce que le consommateur économisera aujourd’hui, sera réglé par le contribuable demain.
Ce renchérissement interroge significativement l’approche stratégique que doivent avoir les élus et les décideurs publics en faveur du développement durable. A la question du coût social et territorial de la transition écologique, si d’aucuns garantissent son financement, tout l’enjeu consiste à la produire.
Force est de constater qu’il nous faut à présent encourager l’investissement dans la transition écologique, certes dans les énergies renouvelables mais surtout dans le nucléaire. Après des années de tergiversations voire de sabordage de la filière nucléaire, feu vert a été donné à la relance du nucléaire français, avec la conception de réacteurs de nouvelle génération (ENR).
Energie au savoir-faire technologique de pointe, le nucléaire apparaît aujourd’hui et plus que jamais au service du pouvoir d’achat et de la lutte contre le réchauffement climatique.
En France, le nucléaire est la première source de production et de consommation d’électricité (70%) et provient de 58 réacteurs de différents niveaux de puissance constituant un parc réparti sur l’ensemble du territoire (19 sites). En 2019, 80% de la production française d’électricité d’origine nucléaire était assurée par quatre régions : l’Auvergne-Rhône-Alpes (22,4 %), le Grand Est (21,8 %) et le Centre-Val de Loire (19,2%) et la Normandie (17,6%).
Au regard des critères primordiaux que sont l’indépendance énergétique de notre pays, la lutte contre le réchauffement climatique, l’égalité dans l’accès à l’énergie sur tout le territoire, garant d’un faible coût de l’énergie, le pouvoir d’achat des ménages, la revitalisation de nos industries, la compétitivité de notre pays ou encore l’équilibre de la balance des paiements de la France, le nucléaire offre des atouts que sa récente labellisation comme énergie verte vient de renforcer.
Il faudra sans doute revenir sur la décision de fermer 12 réacteurs d’ici à 2035, pour redonner des marges de manœuvre au système électrique et adopter un plan Marshall pour le nucléaire, comme le demande le Président de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).
Au-delà d’un programme de construction aux moyens colossaux, d’autres défis seront à relever comme le recrutement de 4 000 ingénieurs par an dans les années qui viennent, comme la montée en compétence toute la filière nucléaire, qui représente aujourd’hui 2 600 entreprises et 220 000 emplois directs et indirects.
L’objectif de la France est bel et bien de préserver la prédominance du nucléaire au sein de notre mix énergétique.
Ce qui signifie réinvestir dans le nucléaire en rénovant le parc nucléaire existant, en construisant 6 EPR et en envisageant des petits réacteurs modulaires pour atteindre l’objectif d’une France zéro carbone en 2050.
Ces mini-réacteurs nucléaires modulaires ou SMR (small modular reactor) représentent une de ces technologies d’avenir cruciales pour répondre à l’urgence écologique à laquelle nous sommes confrontés.
Plus sûrs, plus compacts, productibles en série dans des usines, les SMR promettent une alternative à la production d’électricité à base d’énergies fossiles, dans un contexte d’intense électrification des usages, de l’industrie, du transport, et de développement d’une économie de l’hydrogène vert.
L’intérêt compétitif des SMR porte sur de nombreuses fonctionnalités : chauffer les villes et les usines, produire de l’eau douce par dessalement de l’eau de mer, favoriser la cogénération nucléaire, décarboner la production d’hydrogène et de carburants de synthèse.
Si cette politique sectorielle nécessite un plan de relance gaullien, il y a urgence à mettre fin à l’ensemble des dogmes passionnels qui ont, jusqu’à présent paralysé le débat sur l’avenir du nucléaire. Il conviendra également de faire œuvre de pédagogie auprès de nos concitoyens, trop souvent victimes du discours alarmiste des ayatollahs du verdissement.
Dans cette course à la maîtrise énergétique, le contrat moral qui sera passé entre l’Etat et nos compatriotes, à la fois stratégique, pratique et opposable sera essentiel, si nous voulons nous mobiliser massivement pour le nucléaire et produire une écologie vertueuse car efficace.
Jean ROTTNER
Président du Conseil régional du Grand Est
Vice-Président Mission Ecoter-France et Territoires Numériques