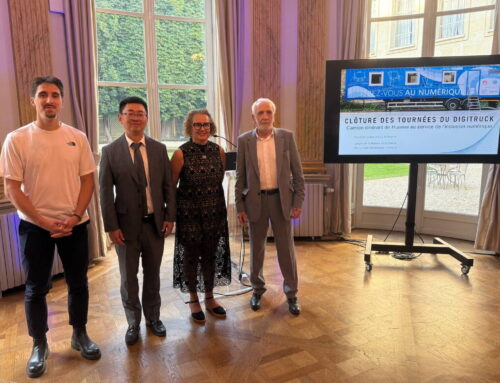Quelle offre de Santé de proximité demain ?
Le phénomène de « désertification médicale » s’est intensifié depuis son origine dans les années 1980; devenu structurel, il touche aujourd’hui des régions entières, y compris de métropoles. La problématique est certes numérique car nous manquons de soignants, mais elle tient aussi à la répartition territoriale des professionnels médicaux et à la répartition entre médecins généralistes et autres spécialistes. Il est donc urgent de réfléchir à une nouvelle offre de Santé de proximité, une offre globale (et non réduite aux seuls soins), avec une approche pluridisciplinaire qui intègre la prévention et les dimensions sociale et psychologique. Et « proximité » ne signifie pas « disposer à sa porte » mais pouvoir bénéficier de l’offre de Santé à une distance raisonnable.
Nous ne pouvons plus faire l’économie de cette réflexion. Faute d’un nombre suffisant de professionnels médicaux dans certains territoires, les délais souvent trop longs pour obtenir un rendez-vous chez un médecin poussent les patients vers les services d’urgence déjà saturés des hôpitaux ou, pire, les conduisent à renoncer ni plus ni moins à la consultation et donc au soin. Ce renoncement provoque l’inégalité des soins. C’est inacceptable sur le plan humain car cette inégalité réduit l’espérance de vie d’un nombre croissant de patients. C’est inacceptable sur le plan social car l’égal accès aux soins pour tous nos concitoyens est un des principes fondateurs de la Sécurité Sociale imaginée par le Conseil National de la Résistance en 1944. Tout le monde doit avoir la même chance de consulter un médecin. Il est d’ailleurs effarant que l’alerte lancée, dès 1991, par le Docteur Saugmann n’ait pas été suivie des actions nécessaires : ce médecin suédois prévoyait pourtant, dans son rapport, un manque catastrophique de médecins dès 2012, dans tous les pays d’Europe, si l’on n’augmentait pas leur nombre d’ici là… Il aura fallu attendre, en France, la présidence d’Emmanuel Macron pour que le numerus clausus soit supprimé…
Il faut un nouveau pacte entre nos concitoyens et leurs soignants qui puisse conjuguer, partout, la garantie d’une offre de Santé de proximité avec des conditions d’exercice optimisées et attractives. Dans cette optique, il est tout autant nécessaire de redonner à la médecine de premier recours, c’est-à-dire, pour la grande majorité des cas, à la médecine générale, une place plus importante dans la chaine de Santé, ce qui va de pair avec une plus grande reconnaissance et une meilleure valorisation de la spécialité. La disparition des cabinets de généralistes met plus en péril l’égalité d’accès aux soins que des fermetures de services de maternité ou d’urgence insuffisamment fréquentés, même si c’est difficile à reconnaitre.
Alors comment augmenter le nombre de médecins généralistes ? Comment pallier le manque de professionnels médicaux dans nos territoires ? Comment convaincre les médecins généralistes et spécialistes de s’installer là où nous en avons le plus besoin ? Comment faire baisser la demande de soins ? Comment mailler à nouveau la France ?
Les élus locaux sont en première ligne pour repenser cette offre et préconiser les changements qui doivent la rendre rapidement opérationnelle et efficace. Il existe déjà beaucoup de rapports, de préconisations, d’initiatives locales qui visent à infléchir les conséquences de la désertification médicale ; il ne faut s’interdire aucune réflexion. L’expérimentation, l’innovation et la différenciation des territoires seront, comme dans d’autres domaines, les clés de la réussite. Nous pouvons rapidement agir sur quatre ressorts essentiels : formation, organisation, digitalisation, prévention.
La formation des étudiants en médecine doit inclure une plus grande sensibilisation aux enjeux de Santé territoriaux et un temps de pratique concrète de la médecine de premier recours, une prise de contact avec le réel multiforme de nos territoires. Pour que le nombre de médecins généralistes augmente, il faut d’abord qu’un nombre plus important d’étudiants s’oriente vers la médecine générale qui est une des spécialités les moins choisies… A l’instar du « choc de simplification » pour les usagers de l’administration, nous devons offrir aux étudiants un « choc d’attractivité » pour qu’ils choisissent la médecine générale. Cela passe notamment par de nouveaux modes de rémunération pour que cette dernière soit revalorisée, plus en adéquation avec le niveau d’études, de responsabilités et même d’utilité sociale (ce principe devrait s’appliquer à l’ensemble des soignants), quel que soit le territoire d’installation choisi et sa situation démographique. Cela passe aussi par des conditions d’exercice optimisées.
L’organisation d’une offre de Santé de proximité passe par l’évolution de ces conditions d’exercice et des modalités d’installation. Tout médecin doit pouvoir trouver l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Nous devons faire le deuil du médecin de famille qui envisageait, au siècle dernier, son métier comme une mission quasi sacerdotale et consacrait sa vie à ses patients, alternant consultation en cabinet et visites à domicile, six jours sur sept. Il faudra ensuite repenser les modalités d’installation de la seule profession médicale qui s’installe où elle le souhaite. Reconnaissons-le, la liberté d’installation ne permet pas d’équilibrer les besoins en médecins (la demande) et la répartition de ces derniers sur le territoire national (l’offre). Faut-il contraindre ? Mais comment, alors, ne pas risquer de freiner les vocations ? La contrainte d’installation ne peut être exclue du débat, quitte à ce qu’elle soit assortie d’une durée déterminée et que sa « levée » ne se fasse que sous réserve de la garantie de l’installation d’un successeur. Mais, sans doute faut-il plutôt inventer, dans un premier temps, un bouquet d’incitations, différentes selon les territoires, susceptibles de convaincre les médecins de venir pratiquer là où le besoin de professionnels est prégnant. Le rôle des élus locaux est, ici, essentiel pour présenter nos territoires à un enjeu démographique sous un nouveau jour. Trop souvent, les étudiants en médecine ont une mauvaise image de certaines villes, de certains départements. Il suffit parfois de les inviter et de leur faire découvrir (c’est que nous faisons à Nevers et dans la Nièvre) pour casser les a priori négatifs et leur expliquer qu’en s’éloignant des métropoles, un médecin peut être bien rémunéré et pratiquer sans le stress de la concurrence, avec un coût de la vie attractif. La chaine de soin devra être renforcée pour permettre aux professionnels de Santé (infirmière en pratique avancée, etc.) de soulager les professionnels médicaux. Nous devrons nous donner les moyens de la solidarité entre tous les acteurs pour que les médecins puissent se concentrer sur le temps médical. Nous devrons enfin faire le bilan d’étape des nombreux dispositifs existant : financement d’assistants médicaux, avantages matériels, contrats d’engagement de service public passés avec des étudiants, maisons de santé, etc., pour les ajuster, les généraliser, les renforcer le cas échéant.
La digitalisation de la médecine est un défi et une des meilleures pistes pour lutter contre la désertification médicale. Elle permet notamment de connecter entre elles les Maisons de Santé Pluridisciplinaires, de réaliser des diagnostics partagés, des échographies à distance, de favoriser les échanges entre praticiens. Des moyens doivent être mis pour déployer la télémédecine et le télésoin afin de couvrir tout le territoire national sans distinction.
Enfin, la prévention doit prendre toute sa part dans la lutte contre la désertification médicale. La saturation des cabinets médicaux s’explique par le vieillissement de notre population et l’augmentation de l’espérance de vie, mais également par une augmentation de pathologies qui pourraient être évitées grâce à la pédagogie et à la prévention. L’Education Nationale a un rôle fondamental à jouer pour enseigner à nos enfants un certain nombre de « bonnes pratiques » : activité physique régulière (ce qui est différent du « sport-compétition-résultat » qui devrait être dévolu uniquement au monde associatif), alimentation, lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, respiration, etc. Une plus grande place est à donner également aux médecines dites intégratives (homéopathie, sophrologie, acupuncture, hypnothérapie, naturopathie, etc.) car les praticiens prennent en compte toutes les facettes de la vie des patients dans le but de prévenir les maladies et de réduire ainsi les besoins de consultations médicales.
Le chantier est donc colossal ! Mais, la Santé de nos concitoyens est à ce prix. Les Français attendent sans doute une version Santé de proximité du « quoi qu’il en coûte ». Des moyens humains et financiers seront nécessaires pour construire cette offre de Santé de proximité, mais il s’agit aussi d’être innovant dans sa conception même et de lutter peut-être aussi contre un certain nombre de conservatismes…
Denis THURIOT
Président de Nevers Agglomération
Maire de Nevers
Conseiller régional de Bourgogne Franche-Comté